Lors du spectacle des Vikings, on assiste au repentir des envahisseurs devant Saint-Philibert.
Nous avons gouverné de si vastes royaumes,
Ô régente des rois et des gouvernements,
Nous avons tant couché dans la paille et les chaumes,
Régente des grands gueux et des soulèvements. Etc....
Ces extraits de prières d'inspiration mystique découlent des cinq prières de la cathédrale de Chartres.
(Chapitre 4. Prière de report).
Les
Cinq
Prières
dans
la
cathédrale
de
Chartres
ont
été
écrites
par
le
poète
et
écrivain
Charles
Péguy
(1873-1914)
à
la
suite
de
son
pèlerinage
pour
rendre
grâce
à
la
Sainte
Vierge
pour
la
guérison
d'un
de
ses
fils (mai 1913).
Il tombera au champ d'honneur le 5 septembre 1914 à Villeroy.
Le
pèlerinage
est
constitué
des
80
km
de
route
plate
et
rectiligne
séparant
la
cathédrale
Notre-Dame
de
Paris à Notre Dame de Chartres.
Si vous souhaitez faire ce pèlerinage, n'oubliez pas votre bâton et vos prières.
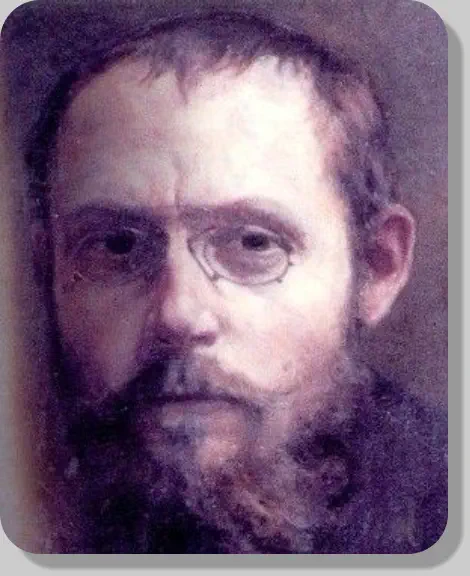

Les Cinq prières de Chartres
Les "Cinq prières de Chartres" représentent un chef-d'œuvre méconnu de la spiritualité française.
Cette série de poèmes religieux, composée par Charles Péguy en 1913, est née d'un pèlerinage personnel à la cathédrale Notre-Dame de Chartres.
Charles Péguy : L'homme derrière les prières
Charles
Péguy,
né
en
1873
à
Orléans
et
mort
prématurément
au
front
en
septembre
1914
lors
de
la
Première
Guerre
mondiale,
incarne
une
figure
intellectuelle
complexe dans la littérature française et passionnée de la Belle Époque française.
Poète et essayiste d'une rare intensité, sa vie fut marquée par une recherche spirituelle profonde qui culmina avec sa conversion au catholicisme vers 1907.
Fils d'artisans orléanais, il vécut dans une France en pleine mutation, tiraillée entre tradition et modernité.
Un parcours intellectuel et spirituel
Péguy incarne l'intellectuel engagé du début du XXe siècle.
L'itinéraire spirituel de Péguy est particulièrement significatif pour comprendre l'origine des "Cinq Prières de Chartres".
Socialiste idéaliste puis catholique fervent, il resta toujours fidèle à ses convictions profondes.
Sa
fondation
des
"Cahiers
de
la
Quinzaine"
en
1900
lui
a
offert
une
tribune
pour
exprimer
ses
idées
et
publier
ses
œuvres
ainsi
que
celles
d'autres
écrivains
importants de son époque.
Cette
revue
est
rapidement
devenue
un
lieu
d'expression
pour
une
pensée
libre
et
engagée,
reflétant
les
convictions
profondes
de
Péguy
sur
la
justice
sociale,
la
spiritualité et le patriotisme.
Il y publia ses œuvres majeures, dont "Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc".
Sa quête spirituelle, faite de doutes et de certitudes, d'éloignements et de retours, se reflète intensément dans ses écrits.
Les
"Cinq
prières
de
Chartres"
constituent
l'une
des
expressions
les
plus
pures
de
sa
foi
retrouvée,
quelques
mois
seulement
avant
sa
mort
prématurée
au
front
en septembre 1914.
Le contexte historique et personnel du pèlerinage
La
création
des
"Cinq
Prières
dans
la
Cathédrale
de
Chartres"
s'étend
sur
une
période
relativement
brève,
mais
intense,
entre
juin
1912
et
l'été
1913
et
trouve
son origine dans un événement profondément personnel de la vie de Charles Péguy.
La maladie du fils
En 1912, son fils Pierre âgé de 10 ans, tombe gravement malade, atteint d'une fièvre typhoïde qui met ses jours en danger.
Face à cette épreuve, Péguy, bien que récemment revenu à la foi, fait un vœu.
Si son enfant guérit, il accomplira un pèlerinage à Chartres pour remercier la Vierge Marie.
Le chemin de reconnaissance
La guérison obtenue, Péguy honore sa promesse.
Le
poète,
qui
avait
39
ans,
marche
trois
jours
durant
sur
les
routes
de
Beauce,
traversant
les
champs
de
blé
et
les
villages,
dans
une
progression
qui
devient
elle-même méditation et prière.
Il parcourt à pied les quelque 80 kilomètres séparant Paris de Chartres, dans un esprit de pénitence et de gratitude, prenant des notes dans de petits carnets.
L'inspiration poétique
Cette expérience bouleversante nourrit sa création littéraire.
L'année suivante, en 1913, il compose les "Cinq prières de Chartres", véritable testament spirituel où s'entremêlent foi personnelle et tradition chrétienne.
Ce
pèlerinage
s'inscrit
également
dans
un
contexte
de
redécouverte
des
traditions
religieuses
françaises
au
début
du
XXe
siècle,
après
les
tensions
entre
l'Église et l'État qui avaient marqué la fin du XIXe siècle.
Chartres : Un haut lieu de la dévotion mariale
La cathédrale Notre-Dame de Chartres constitue l'un des joyaux de l'art gothique français et un sanctuaire majeur de la chrétienté.
Reconstruite après l'incendie dévastateur de 1194, elle représente un témoignage exceptionnel de la foi médiévale.
La Sainte Chemise
La cathédrale abrite une relique vénérée : le "Sancta Camisia" ou "Voile de la Vierge", porté par Marie lors de la naissance de Jésus.
Cette relique, rapportée de Terre Sainte par Charlemagne selon la tradition, a fait de Chartres un centre de pèlerinage dès le Moyen Âge.
Les vitraux bleus
La lumière filtrée par les célèbres vitraux bleus de Chartres crée une atmosphère propice à la contemplation et à la prière.
Cette lumière, presque surnaturelle, transforme l'espace intérieur de la cathédrale en un lieu hors du temps et a profondément marqué Péguy lors de sa visite.
Le bleu de Chartres, d'une intensité particulière, est devenu emblématique de cette cathédrale et symbolise la dimension céleste de ce sanctuaire.
Le labyrinthe
Le labyrinthe de la nef, chemin symbolique de méditation, représente le parcours du pèlerin vers Dieu.
Cette progression lente et réfléchie trouve un écho dans la structure même des poèmes de Péguy.
Pour
Péguy,
Chartres
incarnait
l'âme
française
et
chrétienne
dans
ce
qu'elle
avait
de
plus
pur.
La
cathédrale,
visible
de
loin
dans
la
plaine
beauceronne,
représentait un phare spirituel guidant les âmes en quête de sens.
Structure et titres des "Cinq prières"
Les "Cinq prières de Chartres" forment un ensemble cohérent tout en présentant chacune une tonalité propre.
Cette architecture poétique reflète les différentes facettes de la relation du croyant avec la Vierge Marie.
Prière de Résidence
Évocation de la présence mariale à Chartres et méditation sur l'ancrage spirituel que représente la cathédrale.
Péguy
y
développe
le
thème
de
l'incarnation
divine
dans
un
lieu
précis,
faisant
de
Chartres
un
point
de
jonction
entre
le
ciel
et
la
terre,
où
la
Vierge
"réside"
véritablement au milieu des hommes.
Prière de Demande
Supplique adressée à la Vierge pour obtenir aide et protection, dans la tradition des prières d'intercession.
Le
poète
y
exprime
les
besoins
et
les
souffrances
humaines,
demandant
l'intervention
maternelle
de
Marie
pour
soulager
les
misères
du
monde
et
apporter
la
grâce divine.
Prière de Confidence
Expression intime des doutes et des espoirs du poète, dans un dialogue personnel avec Marie.
Cette
prière,
peut-être
la
plus
personnelle
des
cinq,
dévoile
l'âme
du
croyant
dans
sa
nudité,
avec
ses
faiblesses
et
ses
aspirations,
dans
une
relation
de
confiance filiale avec la Mère de Dieu.
Prière de Report
Méditation sur le temps et l'attente dans la vie spirituelle, sur le report de la grâce divine.
Péguy
y
aborde
la
question
de
la
patience
et
de
l'espérance
face
aux
délais
de
Dieu,
thème
qui
rejoint
sa
propre
expérience
d'une
conversion
tardive
et
d'une
longue attente.
Prière de Déférence
Expression spirituelle caractérisée par une attitude de profond respect, de soumission et de révérence envers la grandeur de Marie, reine du ciel.
Cette dernière prière clôt le cycle par un acte d'humilité et de reconnaissance de la majesté divine.
Le style de Péguy dans ces prières est caractéristique de sa manière tardive : vers libres, répétitions lancinantes, accumulations qui créent un effet de litanie.
Cette forme poétique, à la fois moderne et inspirée des prières médiévales, permet une progression méditative, comme une lente ascension spirituelle.
Les répétitions, si caractéristiques du style de Péguy, ne sont pas de simples ornements rhétoriques.
Elles créent un rythme incantatoire qui accompagne et soutient la méditation.
Chaque reprise d'un mot ou d'une formule apporte une nuance nouvelle, un approfondissement de la pensée.
La structure d'ensemble des "Cinq Prières" peut être comprise comme un pèlerinage intérieur, parallèle au pèlerinage physique accompli par Péguy.
Portée spirituelle et littéraire des poèmes
Une spiritualité incarnée
Les "Cinq prières" témoignent d'une foi profondément incarnée.
Péguy y évoque la Beauce, sa terre natale, les blés mûrs, les chemins de pèlerinage.
Cette géographie spirituelle ancre sa méditation dans le réel tout en l'élevant vers le transcendant.
Sa dévotion mariale s'inscrit dans une tradition française séculaire tout en la renouvelant par une expression poétique singulière.
La langue de Péguy, directe et dépouillée, refuse les ornements inutiles pour atteindre une vérité nue.
Cette simplicité voulue rappelle la nudité de la prière authentique, où l'âme se présente sans fard devant Dieu.
L'œuvre opère une synthèse remarquable entre la prière personnelle et la dimension collective de la foi.
Le poète parle en son nom propre mais aussi au nom de tous les croyants, dans une communion qui transcende le temps.
Ses invocations à Marie font écho aux innombrables prières des pèlerins qui l'ont précédé à Chartres.
Réception et héritage de l'œuvre
Les "Cinq prières de Chartres" ont connu un destin particulier dans l'histoire littéraire et spirituelle française.
Initialement publiées dans les "Cahiers de la Quinzaine", elles n'ont pas immédiatement rencontré une large audience.
Redécouverte après la Grande Guerre
La
mort
héroïque
de
Péguy
dès
les
premiers
jours
de
la
Première
Guerre
mondiale
interrompit
brutalement
la
diffusion
de
sa
pensée,
mais
a
contribué
à
une
relecture de son œuvre.
Ses prières sont alors perçues comme le testament spirituel d'un poète-soldat.
Cette dimension est renforcée par le contexte historique.
Composées
à
la
veille
de
la
Première
Guerre
mondiale,
ces
prières
portent
en
elles
le
pressentiment
d'un
monde
qui
va
s'effondrer
et
témoignent
d'une
quête
d'absolu face à la menace de la violence et du chaos.
C'est
dans
l'entre-deux-guerres
que
l'œuvre
de
Péguy,
et
notamment
ses
écrits
spirituels,
commencèrent
à
trouver
un
lectorat
plus
large,
inspirant
le
renouveau de la spiritualité catholique française.
Renaissance du pèlerinage
À partir des années 1930, le pèlerinage pédestre entre Paris et Chartres est recréé, explicitement inspiré par la démarche de Péguy.
Cette tradition perdure aujourd'hui, rassemblant chaque année des milliers de pèlerins qui marchent sur les traces du poète.
Le "pèlerinage de Pentecôte" est devenu l'un des plus importants de France, témoignant de l'influence durable de Péguy sur la spiritualité catholique française.
Reconnaissance littéraire
L'œuvre est progressivement entrée dans le canon littéraire français, étudiée pour sa valeur poétique autant que pour sa dimension spirituelle.
Elle incarne une poésie religieuse moderne qui ne sacrifie ni la foi ni l'exigence artistique.
Aujourd'hui,
les
"Cinq
prières
de
Chartres"
continuent
d'inspirer
croyants
et
non-croyants,
témoignant
de
la
persistance
d'une
œuvre
qui
transcende
les
clivages entre littérature profane et texte religieux.
Conclusion : Un classique, entre foi et littérature
Les "Cinq prières de Chartres" occupent une place unique dans la littérature spirituelle française.
Elles représentent l'aboutissement de la quête religieuse de Charles Péguy, tout en incarnant un renouveau de la dévotion mariale au début du XXe siècle.
Cette
œuvre
reste
indissociable
de
l'histoire
personnelle
de
son
auteur,
sa
conversion
en
1907,
le
pèlerinage
accompli
pour
la
guérison
de
son
fils,
mais
aussi
de
la tradition chartraine (de Chartres) millénaire.
La cathédrale, ses vitraux bleus, sa Vierge vénérée constituent plus qu'un décor.
Ils sont la matrice même de l'inspiration poétique.
Par-delà leur dimension religieuse, ces prières nous interrogent sur les liens entre expérience spirituelle et création littéraire.
Péguy démontre qu'une authentique démarche de foi peut nourrir une œuvre d'art exigeante, sans concession ni sur le plan spirituel, ni sur le plan esthétique.
Cent ans après leur composition, les "Cinq prières de Chartres" continuent de résonner pour les lecteurs contemporains.
Elles
nous
invitent
à
redécouvrir
ce
dialogue
entre
ciel
et
terre,
entre
tradition
et
modernité,
entre
prière
personnelle
et
héritage
collectif
qui
caractérise
la
grande littérature spirituelle.


